C’est dans un contexte très particulier que se tient actuellement à Paris la COP21, à laquelle participent 147 chefs d’État. On imagine facilement les mesures de sécurité imposées par un tel événement au regard des derniers attentats qui ont touché la capitale française et des tensions palpables sur l’échiquier géopolitique mondial. Durant deux semaines, 196 délégations vont tenter de se mettre d’accord sur les modalités à mettre en oeuvre à l’échelle planétaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous d’un seuil de 2°C.
Il convient, ici encore, de parvenir à une coalition internationale pour lutter efficacement contre ce risque. Les négociations sont en cours depuis un an déjà et tous les États ont été invités, en amont de la manifestation, à communiquer leur contribution en matière de réduction de gaz à effet de serre.
Établissant un état des lieux des conséquences sociales et économiques de ce dérèglement climatique, un récent rapport de l’ONU permet de prendre conscience des enjeux. Il indique que les caprices de la météo obligent chaque année à porter assistance à 200 millions de personnes, et engendrent quelque 250 milliards d’euros de dépenses. On comprend mieux pourquoi les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour aider les pays en développement à faire face au changement.
Le challenge est considérable puisqu’il consiste à changer tous nos référentiels économiques en modifiant notre façon de produire et de consommer. Pour les pays développés, qui ont assis leur croissance sur leur industrie, les transformations à opérer sont faramineuses. De nombreux secteurs d’activités sont concernés : transport, BTP, industrie, agriculture. Pour les pays en développement, le défi est de changer immédiatement de modèles, sans être autorisés à suivre le même chemin que leurs aînés pour grandir.
Dans tous les cas de figure, les entreprises sont donc au coeur de la réflexion, par leur production, mais également en consommant des matières premières et des ressources naturelles, en générant des déchets, et en offrant des ressources à leurs salariés. Il est alors indispensable que celles-ci mettent en place de nouvelles pratiques.
Mais cette logique rencontre un frein majeur lié au coût présumé du changement. On peut pourtant agir sur certains leviers : réduction des consommations d’énergie, revalorisation des déchets, amélioration de la productivité, mobilisation des équipes, maîtrise des risques environnementaux, sont autant de sources d’économie pour l’entreprise. De plus, un positionnement éco-responsable peut aujourd’hui être une source d’innovation, de différenciation avec la concurrence, de préservation de son image et, in fine, de parts de marché supplémentaires.
C’est en convainquant les entreprises de l’intérêt financier d’une telle démarche que l’on construira le changement. Cet intérêt est déjà largement perceptible dans des domaines comme le bâtiment (RT 2012, rénovation énergétique, PTZ, bâtiment à énergie positive), le transport (maîtrise des consommations principalement), et bien sur les énergies renouvelables. Il convient principalement de l’étendre au monde de l’industrie.
Certains verront dans cette démarche une façon d’inventer un nouveau
modèle capitaliste vert. Mais a-t-on vraiment d’autres perspectives à l’heure actuelle ?






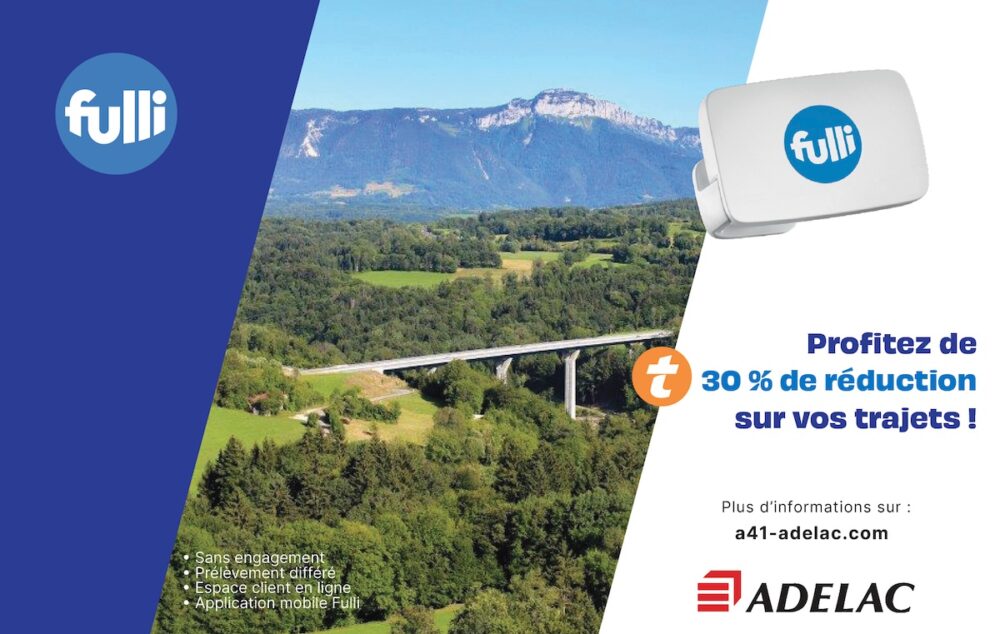















0 commentaires