Plus de journées chaudes, baisse de l’enneigement, diminution du nombre de jours de gel… les impacts du changement climatique menacent de plus en plus de sites en Auvergne-Rhône-Alpes.
«Certains jours de grande chaleur, on a même vu des visiteurs se baigner dans des abreuvoirs à vaches ! » Le réchauffement climatique va-t-il faire bouillir le cerveau des randonneurs ? C’est ce que redoute Benoît Tiberghien, chargé de mission au parc naturel régional du massif des Bauges. Bien sûr, tous les comportements étonnants ne sont pas forcément liés au réchauffement climatique.
Mais force est de constater que ceux des visiteurs et des professionnels se trouvent modifiés par les évolutions environnementales. C’est ce que montre l’étude d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme – la première du genre – au sujet de l’impact du changement climatique sur les activités de pleine nature en montagne. Elle a été réalisée en partie en ligne, auprès de 125 acteurs de l’outdoor, regroupés autour de cinq activités (alpinisme, randonnée pédestre, VTT, baignade, eau vive).
700, c’est le nombre d’écroulements qui ont été comptabilisés entre 2007 et 2017 dans le massif du Mont-Blanc, causés par le dégel du permafrost et la diminution du manteau neigeux.
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
Plus brutal en montagne
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’analyse de l’évolution des températures annuelles montre un net réchauffement du territoire. D’après l’Observatoire de l’Espace Mont-Blanc, les effets du réchauffement climatique sont plus brutaux et plus rapides dans le milieu montagnard. Et, en effet, on constate une augmentation annuelle moyenne de 0,2 à 0,5 degré par décennie, ainsi qu’une hausse significative de la fréquence des journées caniculaires.

Le dégel du permafrost et la diminution du manteau neigeux déstabilisent les parois de haute montagne. Plus de 700 écroulements ont été comptabilisés entre 2007 et 2017 dans le massif du Mont- Blanc. « J’habite à 1700 mètres d’altitude et, cette année, on avait des températures positives encore juste avant Noël », s’inquiète Nicolas Raynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM).
Et pour cause, le milieu de l’alpinisme est le plus touché par les effets du changement climatique. Les 120 refuges gérés par la fédération sont soumis à des mouvements de terrain et des éboulements. Des fissurent apparaissent et les bâtiments deviennent alors instables. Pour autant, « l’alpinisme n’est pas mort à cause du réchauffement climatique, il continue d’attirer de nouveaux pratiquants », affirme le passionné de montagne qu’est Nicolas Raynaud.
Si le terrain de pratique évolue, la discipline doit se réinventer. « C’est ce que cherche à faire la fédération : ne pas tomber dans le piège de l’artificialisation de la montagne, mais au contraire réinventer les itinéraires et la saisonnalité », complète-t-il.
« La montagne détient, grâce à sa diversité de paysages, les clés de la résilience ».
Samuel Morin, directeur du Centre d’études de la neige Météo France
9 sur 10
L’étude montre qu’en moyenne, 63 % des professionnels de l’outdoor interrogés voient leur activité touchée par au moins un aspect du bouleversement climatique, et ils sont près de 9 sur 10 à constater des transformations de l’environnement. Dans le détail, 86 % des professionnels de l’alpinisme, 69 % dans le domaine de la randonnée pédestre, 74 % pour les activités d’eau vive et 43 % dans le secteur du VTT ont remarqué au moins un changement majeur concernant leur domaine.
Les conséquences des canicules et des épisodes orageux impactent plus particulièrement les terrains des activités VTT et randonnée pédestre. Les milieux sont fragilisés et cela entraîne inévitablement des glissements de terrain ou autres ravinements. Pour les activités d’eau vive et de baignade, le manque d’eau est identifié comme l’impact majeur du changement climatique. La baisse du niveau d’eau et les débits insuffisants rendent difficile la pratique d’activités à certaines périodes.
La montagne est-elle pour autant plus vulnérable que les autres milieux ? « Pas nécessairement, mais elle est plus révélatrice », selon Samuel Morin, directeur du Centre d’études de la neige Météo France basé à Grenoble. « Le retrait glaciaire ou la diminution de l’enneigement à moyenne altitude font partie des marqueurs visibles des changements en cours. L’altitude fait que l’on peut être dans un environnement très différent, avec des effets et impacts du changement climatique très contrastés. »
Pour le spécialiste, « la montagne détient, grâce à sa diversité des paysages, les clés de la résilience ». Selon lui, « l’approche la plus adéquate est double : atténuation par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et adaptation ». Tout un programme.

L’engagement des professionnels : s’adapter et changer leur communication
L’étude montre que 6 professionnels interrogés sur 10 ont déjà engagé des actions pour s’adapter au changement climatique dans le cadre de leur activité principale. Mais ils sont moins de 3 sur 10 à envisager des actions dans un futur proche. L’action majoritairement engagée concerne la communication. Par exemple, les professionnels de l’alpinisme communiquent davantage sur les courses de rochers.

De son côté, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme recommande aux acteurs une série d’actions à mettre en oeuvre avec pour objectif d’adapter les activités outdoor et les territoires au changement climatique : favoriser les échanges entre territoires et socioprofessionnels afin de permettre une meilleure compréhension des besoins de chacun, partager les connaissances, sensibiliser les décideurs, les acteurs économiques et le grand public.
En plus du réchauffement, la surfréquentation
Les sites de moyenne montagne ont été la destination en vogue l’été dernier, lors de la fin du premier confinement. Au parc naturel régional du massif des Bauges, un constat a été fait : la hausse de la fréquentation d’un écosystème déjà fragile entraîne une détérioration des milieux naturels.

« Le plus visible a été tout ce qui a trait à l’eau, aussi bien sur les sites de baignade comme le lac de Lescheraines que sur les rivières. L’été dernier, pour la première fois, un arrêté préfectoral a été pris concernant l’interdiction d’accès à l’eau », explique Benoît Tiberghien, chargé de mission au parc. Un paradoxe quand les visiteurs cherchent avant tout à se rafraîchir.
« En période estivale, on observe par exemple des tronçons qui disparaissent sur la rivière du Chéran », complète-t-il. La perturbation humaine liée aux baignades estivales peut modifier la vitesse d’écoulement de l’eau et, du même coup, augmenter sa température. Au risque de perturber le milieu aquatique qui va avec, comme « les emblématiques truites des rivières dites froides situées en Bauges ».
De manière générale, les lacs de montagne ou les rivières enregistrent une recrudescence de fréquentation. Le massif des Bauges, constitué à 60 % de forêt, voit également apparaître de plus en plus de phénomènes épisodiques de sécheresse. « Cela influe sur la situation sanitaire des arbres, soumis à un stress, et donc les fragilise », développe Benoît Tiberghien. Combiné à des épisodes venteux plus fréquents, les parcours d’accrobranches pourraient être de plus en plus touchés.
« Au printemps 2019, il y a eu une tempête qui a ravagé le site d’accrobranche du fort de Tamié », constate le chargé de mission. Dans tous les cas, entre phénomène de réchauffement climatique et surfréquentation, si la montagne continue à être attractive, les professionnels seront confrontés « à gérer encore plus les conflits d’usages entre les visiteurs et les habitants des communes rurales », conclut-il.







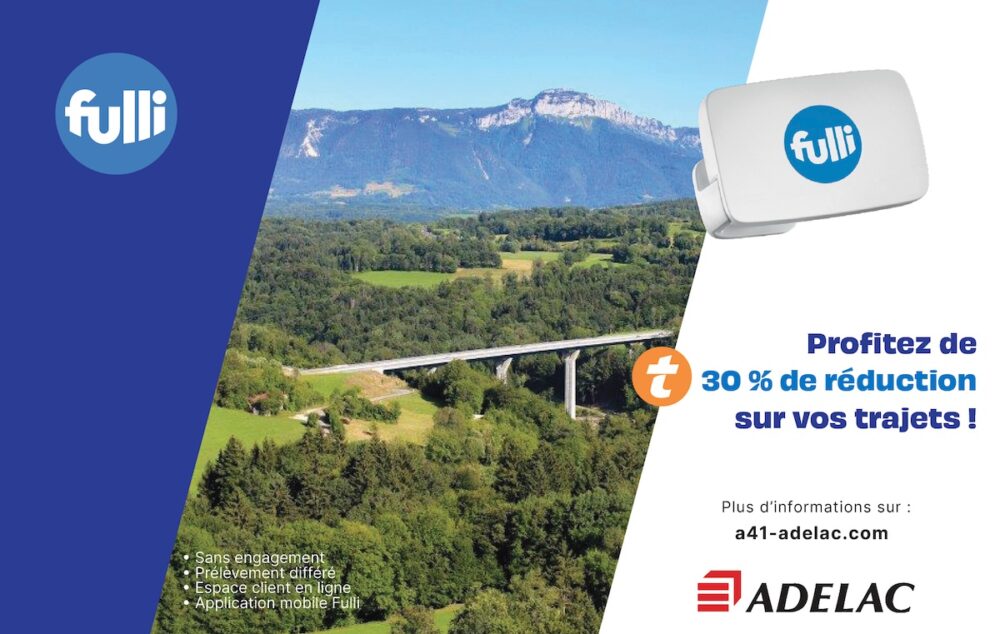
















0 commentaires