Une étude de l’Irstea de Grenoble met en évidence un phénomène surprenant : en s’évaporant moins, les glaciers risquent de fondre plus vite. Explication.
Pour tenter d’analyser les phénomènes de fontes extrêmes des glaciers et de les comparer à la fonte inhérente au réchauffement climatique les chercheurs grenoblois de l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) ont épluché les relevés de masse glaciaire disponibles sur 70 ans pour le glacier de Sarennes en Isère, à 2850 m d’altitude, une base de données exceptionnelle et quasi unique au monde. Et ils les ont croisé avec les relevés de températures atmosphériques fournis par Météo France. Le résultat les a surpris.
Premier constat : les flux énergétiques lors des fontes extrêmes sont différents de ceux de la fonte « classique ». Dans le premier cas, c’est surtout le rayonnement solaire qui est en cause. Dans le deuxième, c’est principalement le rayonnement infrarouge et… la réduction du phénomène d’évaporation de la glace, en surface du glacier. Etonnant, car les chercheurs s’attendaient à ce que ce phénomène d’évaporation soit au contraire plus important.
Moins d’évaporation donc plus de fonte
« Avec le réchauffement de l’air, la glace devrait s’évaporer de plus en plus, note l’Irstea. Mais ce processus est en fait contrebalancé. Plus l’air est chaud, plus il contient de vapeur d’eau qui, au contact du glacier, limite l’évaporation. Bilan : comme l’évaporation est un processus consommant beaucoup d’énergie, sa limitation rend davantage d’énergie disponible pour la fonte. »
Ce n’est pas anodin. Car les scénarios climatiques actuels prévoient une hausse des températures de l’air avec hausse des gaz à effet de serre et de vapeur d’eau. Outre l’augmentation du rayonnement infrarouge, les scientifiques s’attendent donc à ce que la réduction de l’évaporation s’accentue et… accélère davantage encore la fonte des glaciers.
L’étude a été menée en collaboration avec le Centre d’études de la neige (Météo France, CNRS) et l’Institut de Géosciences de l’Environnement (CNRS/INSU, IRD, Université Grenoble Alpes, Grenoble-INP). La synthèse de cette étude est à lire sur le site de l’Irstea : http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/fontes-extremes-glaciers.

La fonte du glacier de Sarennes en 110 ans. Crédits photos : G. Flusin et E. Thibert. Source : site web de l’Irstea – http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/fontes-extremes-glaciers .
Un logiciel encore plus fiable sur les conséquences de la fonte des neiges
Ce n’est pas directement en lien avec l’étude sur la fonte des glacier mais en même temps que ces résultats l’Irstea annonce parallèlement une amélioration de la modélisation de la fonte des chutes de neige. En 2010, l’institut avait déjà été à l’origine d’un premier logiciel permettant de modéliser cette fonte et ainsi d’anticiper ses répercussions sur les cours d’eau (hausses des débits, crues potentielles). A l’issue de nouveaux travaux il est parvenu à améliorer cet outil.
Jusque là le logiciel ne prenait en compte que les précipitations : neige mais aussi pluie, pour laquelle la modélisation de l’impact sur les cours d’eau est déjà ancien; et les températures. Mais il fonctionnait aussi beaucoup à partir d’estimations (il n’y a pas des capteurs partout). La nouvelle mouture inclut des bases de données satellitaires (photos) et de mesures réelles (capteurs) ainsi qu’une modélisation de la variabilité de la fonte dans le bassin versant (notamment en différenciant versant sud et nord).
L’avantage est double, explique l’Irstea : d’une part l’outil est plus fiable pour prévoir à brève échéance les variations de débits et les crues potentielles. D’autre part, plus globalement, il va permettre de mieux étudier « l’impact du changement climatique sur les débits des rivières des régions de montagne. Et, au-delà, sur la disponibilité de la ressource en eau et la survenue des crues (période, intensité), deux enjeux cruciaux pour l’avenir de ces régions. »

Modéliser la fonte des neiges et ses conséquences sur l’hydrologie ou aider les stations à mieux gérer l’enneigement sont aussi des thèmes de travail pour l’Irstea. Crédit photo : Eric Renevier.
EGU : 15 000 spécialistes se rencontrent
Que l’Irstea rende plubliques ces deux informations ces jours-ci n’a rien d’un hasard : du 9 au 13 avril se déroule l’assemblée générale de l’Union européenne des géosciences (EGU). L’événement rassemble à Vienne, en Autriche, près de 15 000 chercheurs du monde entier spécialistes de l’hydrologie. L’occasion de découvrir de nombreuses avancées en termes de recherche sur l’hydrologie et la neige.
L’Irstea est évidemment présent sur l’événement. L’institut et ses différents partenaires y communiquera sur plusieurs projets en cours. Parmi lesquels se trouve aussi Prosnow, qui porte sur les prévisions météo et la gestion de l’enneigement des domaines skiables à l’échelle d’une saison.







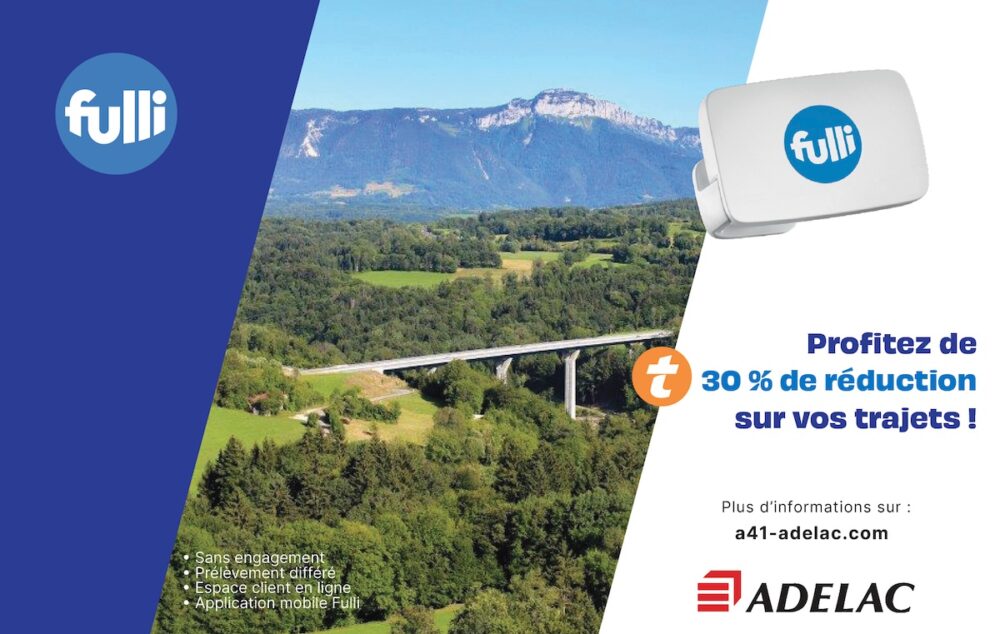












0 commentaires